
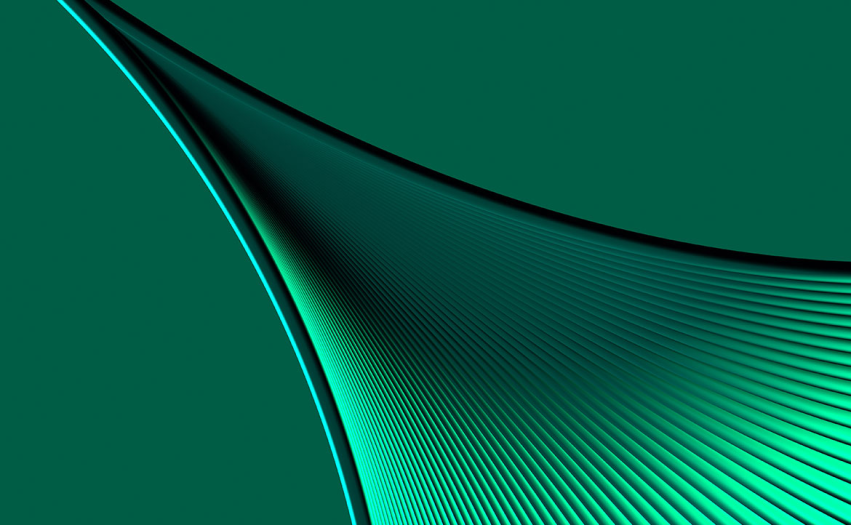
Réformer la comptabilité, changer la gestion
De nombreuses entreprises prennent désormais en compte l’impact environnemental de leur activité, sans nécessairement ajuster leur modèle économique. Pour les scientifiques qui défendent une refonte totale des règles comptables, l’essentiel reste à faire.
Les lignes bougent. Les entreprises prennent conscience de leurs responsabilités vis-à-vis de leur environnement, ou du moins du risque encouru à les ignorer. Pour accélérer ce mouvement et inciter les groupes à intégrer au cœur de leur activité la protection de la nature, des comptables, des économistes, des scientifiques… estiment qu’il est nécessaire de réformer les règles comptables. Certains d’entre eux défendent même une modification de l’ADN du capitalisme afin d’accorder au capital humain et au capital naturel le même statut que le capital financier. Ainsi, depuis l’après-guerre, ces professionnels, de moins en moins marginaux, planchent pour introduire dans les comptabilités nationales, et notamment dans la mesure de la croissance, la question de la gestion des ressources naturelles. Les actuaires, eux, restent à la marge. Pourtant, « ils ont un rôle à jouer dans ces réflexions autour de la comptabilité car, spécialistes de la modélisation et de la gestion des risques sur le long terme, ils peuvent contribuer à bâtir ces nouveaux modèles adaptés à la préservation de l’environnement, estime Pierre Thérond, conseiller scientifique de L’Actuariel, actuaire agrégé IA. Aujourd’hui, la profession a commencé à intervenir sur ces sujets par le biais des investissements des compagnies d’assurance et de la prévention ».
En 2010, l’économiste indien Pavan Sukhdev a ainsi remis un ambitieux rapport sur l’économie de la biodiversité, commandité par les ministres de l’Environnement du G8. S’appuyant sur une méthode développée par la Banque mondiale, il estimait les services rendus par la nature aux différentes activités économiques « à 23 500 milliards d’euros par an », soit la moitié du PIB mondial de l’époque. D’autres scientifiques estiment que la notion de prix en ce qui concerne la nature n’a aucun sens, à l’instar de Jacques Weber, du Cirad (Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement), décédé il y a quatre ans. Ce dernier proposait alors, pour protéger la biodiversité, d’instaurer un système de taxation de toutes les consommations de nature : énergie, eau, ressources renouvelables et non renouvelables.
Un pendant microéconomique aux réflexions sur la croissance s’est ainsi développé à partir des années 1980 pour donner naissance à de multiples méthodes d’identification, d’évaluation, de gestion, de reporting… Si leur point commun est de mesurer les relations entre les entreprises et l’environnement, leurs ambitions diffèrent (voir encadré). Dans ce contexte, plusieurs organisations de poids comme la Biodiversity Platform, le Cambridge Natural Capital Impact Group ou encore la Natural Capital Coalition cherchent à organiser le partage des meilleures pratiques de mesure et à pousser à une certaine standardisation.
Des fondements philosophiques et idéologiques
« Le système comptable actuel a été inventé au XIVe siècle par des entrepreneurs qui voulaient s’assurer de pouvoir transmettre leur entreprise à leurs fils. À l’époque, cela avait un sens. Aujourd’hui, décider que seul le capital financier mérite d’être conservé est parfaitement inique », affirme le Français Jacques Richard, professeur émérite à l’université Paris-Dauphine et expert-comptable.
Aussi a-t-il inventé un modèle alternatif de comptabilité, intitulé Care : comptabilité adaptée au renouvellement de l’environnement. « On ne réalise pas toujours tous les présupposés idéologiques, philosophiques et moraux que porte un système comptable, explique-t-il. Mon système propose de mettre au passif des entreprises non plus un capital mais trois : capital financier, capital naturel et capital humain. » L’idée centrale est d’étendre le bilan et le compte de résultat classiques en considérant les êtres humains et les « entités » environnementales employés par l’entreprise comme un passif et non plus un actif ou une charge. Une telle logique permet d’appréhender l’usage des êtres humains et de la nature comme un emprunt qu’il est nécessaire de pouvoir « rembourser ». Leur maintien devient donc essentiel. Le modèle Care « n’attend pas la survenance des désastres ni même une hausse des températures pour enregistrer une charge : il le fait au moment où un événement arrive qui remet en cause la capacité ultérieure du fonctionnement du capital concerné », explique Jacques Richard.
Le modèle Care souffre toutefois de quelques limites, relève Michel Trommetter, directeur de recherche à l’Inra à Grenoble, dans une étude de 2015 pour le Commissariat général au développement durable : difficulté de qualifier la qualité du capital naturel, absence de prise en compte des interactions entre les acteurs et absence de prise en compte des incitations à investir en biodiversité.
Les entreprises tâtonnent
La France ne s’est pas encore convertie au modèle Care, qui nécessite de remettre à plat toutes les règles comptables, mais le pays s’imprègne de ces sujets. Les exemples de bonnes pratiques se multiplient. « Des compagnies, pétrolières notamment, intègrent dans les modèles de rentabilité qui supportent les prises de décision, des coûts environnementaux – par exemple le prix interne du carbone – qui dépassent leurs coûts financiers immédiats, explique ainsi Pierre Thérond. La matérialisation dans les comptes de cette pratique, avec les informations appropriées, serait un pas significatif à la généralisation et au renforcement de ces efforts devenus indispensables. »
Les réformes réglementaires y sont pour beaucoup. Ainsi, la loi responsabilité environnementale (LRE) de 2008 a instauré pour les grandes entreprises une obligation de reporting extra-financier. Elle stipule que les entreprises causant des dommages graves à l’environnement doivent les réparer en nature, c’est-à-dire en mettant en place un projet de restauration du milieu endommagé. Différentes méthodes d’évaluation – basées sur l’identification d’un proxy (indicateur écologique ou biologique représentatif du milieu endommagé ou de calculs biophysiques) – sont proposées par le ministère, comme les méthodes HEA (Habitat Equivalency Analysis) et REA (Resource Equivalency Analysis). Celles-ci exigent de récolter une quantité importante de données sur le terrain, afin de dimensionner le projet de restauration écologique en fonction de la totalité du dommage subi, en calculant les pertes enregistrées pendant toute la durée d’impact du dommage.
Les mentalités évoluent
« Depuis le Grenelle de l’environnement, les grandes entreprises prennent en compte leurs externalités environnementales négatives via leurs indicateurs extra-financiers. Elles sont maintenant capables de les mesurer précisément, détaille Fabrice Bonnifet, directeur développement durable du groupe Bouygues et président du Collège des directeurs du développement durable (C3D). Si les entreprises s’arrêtent là, la démarche ne sert évidemment à rien ! L’ambition derrière la loi est que chacun bâtisse un plan d’action pour réduire voire supprimer ces externalités. »
« Dans un premier temps, les entreprises se sont contentées d’améliorer leurs processus et leurs produits habituels, sans pour autant changer les fondamentaux de leur modèle économique. Il est clair désormais que cela ne suffit pas. Cependant changer radicalement de modèle est long et compliqué, car cela implique de tout revoir dans le système de conception, de production et de commercialisation. Aujourd’hui la plupart des grandes entreprises, comme Bouygues, Michelin, Danone, Seb, Carrefour, Suez…, testent des modèles alternatifs qui cohabitent avec leurs modèles traditionnels », affirme ce haut cadre. Cependant, pour Hervé Gbego, président du cabinet Compta-durable, spécialisé en comptabilité écologique, différents profils coexistent encore : les indifférents, ceux qui lancent des actions surtout pour la communication et les bons élèves. « Danone est par exemple très avancé, juge l’expert-comptable. Le groupe s’est doté d’un panel d’outils de mesure pour calculer l’impact social et environnemental de ses décisions. Au Bangladesh, il a monté un partenariat avec Grameen Bank pour produire des yaourts adaptés, par leur prix et leurs qualités nutritives, aux besoins du pays. » Dans ce pays en proie à la malnutrition, le groupe a en effet opté pour un modèle de micro-usines tout juste rentables, qui produisent des yaourts très peu chers : toute la chaîne a été repensée pour s’adapter à l’environnement économique et social. « Nous savons qu’Amazon détruit chaque année des millions d’objets neufs, abonde François-Michel Lambert, député (Libertés et Territoires) des Bouches-du-Rhône et président-fondateur de l’Institut de l’économie circulaire. La solution n’est pas de l’interdire mais de changer les règles comptables. Avec les règles actuelles, détruire des stocks est cohérent : cela améliore le fonds de roulement de l’entreprise. Il faut que les règles comptables rendent la destruction plus compliquée et inciter les entreprises à aller vers le don. »
Dans le même esprit, le rapport Notat-Senard de mars 2018 – commandité par les ministres de la Transition écologique et solidaire, de la Justice, de l’économie et des Finances et du Travail pour alimenter le projet de loi Pacte défendu par Bruno Le Maire, le ministre de l’Économie – notait ainsi dans une de ses recommandations : « Toute compréhension de l’entreprise passe par sa comptabilité. Or les enjeux sociaux et environnementaux qui doivent être considérés en sont absents. De même que le droit des sociétés a pu apparaître décalé avec la réalité, la comptabilité strictement financière ne donne pas une image fidèle de la pratique des entreprises. » La recommandation n’a pas été reprise dans le projet de loi, mais François-Michel Lambert, très investi sur ces sujets, ne baisse pas les bras. « Je porte ces sujets de comptabilité écologique à l’Assemblée nationale, mais aussi auprès du ministre et de ses conseillers. J’avais passé un amendement en ce sens lors de la loi Pacte, qui n’est pas passé. Mais on va repartir de l’avant. Il est inéluctable d’introduire ces questions de préservation des ressources. » Le colloque intitulé « La comptabilité au service de la transition environnementale et sociale », le 7 février dernier à l’Assemblée, a notamment pu lui permettre de familiariser ses confrères avec ces sujets.
Le frein international
Si, en France, la comptabilité écologique commence à avoir pignon sur rue, elle ne pourra s’imposer sans une reconnaissance internationale. Depuis le XIVe siècle, toutes les entreprises qui commercent ensemble dans le monde utilisent un système comptable identique. Revenir sur cette universalité n’est pas une option. Modifier les règles dans le sens de la comptabilité écologique nécessite dès lors de convaincre l’ensemble des parties prenantes. Or la production des normes comptables internationales a été confiée depuis les années 1980 à un organisme indépendant, rebaptisé de puis 2001 l’International Accounting Standards Board (IASB). Toutes les sociétés cotées en Bourse doivent se conformer au cadre fixé par les International Financial Reporting Standards (IFRS). Contrairement à l’Autorité des normes comptables française, qui estime que la comptabilité doit répondre d’une visée publique, l’IASB se fonde sur l’intérêt privé des actionnaires.
L’IFRS 9 pose notamment problème sur les sujets d’investissement à long terme. Ce standard prévoit que les investissements en instruments de capitaux propres soient valorisés à la juste valeur avec les variations en compte de résultat, ce qui, pour les critiques, favoriserait la volatilité des investisseurs.
L’IASB n’est toutefois pas totalement hermétique aux questions écologiques. Elle a soutenu le lancement en 2011 d’un International Integrated Reporting Council. Cette montée en puissance du reporting intégré a suivi l’adoption en mai 2010, par 72 États représentés par des délégations composées de membres de la société civile, de la norme ISO 26000 fixant les grands domaines de la responsabilité sociale des entreprises (RSE). « Les choses évoluent peu à peu : en 2018, 21 groupes du CAC 40 ont publié un rapport intégré, qui détaille la façon dont les entreprises se transforment pour assurer la transition vers des modèles d’affaires plus durables en concertation avec leurs parties prenantes », note ainsi Fabrice Bonnifet.
L’urgence du changement
Les tenants de la méthode Care se montrent toutefois très sceptiques. « Le reporting intégré peut faire des dégâts car il n’a pas de visée écologique. Son point de départ est de se demander ce que l’environnement apporte de plus à la valeur actionnariale. L’objectif reste d’optimiser le good-will interne », avance le chercheur Alexandre Rambaud. « Cela n’a rien à voir avec ma méthode car les IFRS sont conservés. Il ne s’agit que de reporting, une réflexion sur la manière d’exploiter plus intelligemment la nature mais il n’y a aucune idée de protection, aucun intérêt aux cycles de la nature », abonde Jacques Richard, qui craint que les entreprises se dédouanent de leurs responsabilités derrière leurs rapports intégrés.
Autre frein, et de taille, les positions très fermées des États-Unis. Résultat, seule une action concertée au niveau de l’Union européenne pourrait influer sur les standards internationaux. Alors, si le Vieux Continent a adopté les normes IFRS en 2002 sans mener de vraie réflexion politique, dix-sept ans plus tard, il est encore temps d’organiser le débat !






















